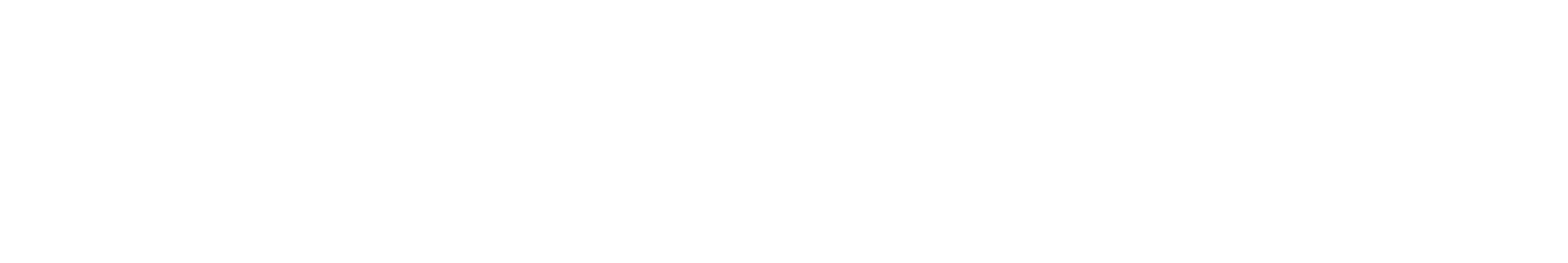Article de Marina Kousouri – Psychologue Clinicienne
« Sauver les corps » : pour l’abolition de la peine de mort, physique et psychique
Pour sauver l’homme, il faut « sauver les corps », ainsi que l’appelait à le faire Albert Camus dans Ni victimes ni bourreaux : « ma conviction est que nous ne pouvons plus avoir raisonnablement l’espoir de tout sauver, mais que nous pouvons nous proposer au moins de sauver les corps pour que l’avenir demeure possible »[1]. A l’inverse, toute crise de l’homme passe par une crise du corps, que la peine capitale incarne à l’extrême : « il y a une crise de l’homme, puisque la mise à mort d’un être peut être envisagée autrement qu’avec l’horreur et le scandale qu’elle devrait susciter »[2]. Camus en tire une conclusion sans appel : « j’ai décidé de refuser tout ce qui, de près ou de loin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, fait mourir ou justifie qu’on fasse mourir ». Il fait de la préservation des corps le premier problème sur lequel il faut se concentrer. La base de toute politique doit être, non plus de maîtriser les corps vivants, de les rendre dociles, mais simplement de les préserver, de les sauver de la mort imposée par l’homme : « si la peur n’est pas le climat de la juste réflexion, il (…) faut donc d’abord se mettre en règle avec la peur. Pour se mettre en règle avec la peur, il faut voir ce qu’elle signifie et ce qu’elle refuse. Elle signifie et refuse le même fait : un monde où le meurtre est légitimé et où la vie humaine est considérée comme futile. Voilà le premier problème politique aujourd’hui. Et avant d’en venir au reste, il faut prendre position par rapport à lui »[3]. Or, « nous vivons justement dans un monde où le meurtre est légitimé et nous devons le changer si nous n’en voulons pas »[4].
Ce mot d’ordre de Camus, nous devons le faire nôtre. « Oui ou non, directement ou indirectement, voulez-vous tuer ou violenter ? Oui ou non, directement ou indirectement, voulez-vous être tué ou être violenté ? »[5]. La force d’un tel propos est que, s’il concerne en priorité la peine de mort et appelle à son abolition, il possède une portée bien plus large. Ces deux questions posent les bases d’une politique des corps. Dans un premier temps – et Camus en reste là – il s’agit de « sauver les corps » en prenant conscience de la « crise de l’homme » que soulignent avec acuité et cruauté deux phénomènes : la peine de mort individuelle d’une part ; la guerre, cette peine de mort collective, d’autre part. Il appelle à une prise de conscience aigue de la situation, dont il laisse entrevoir une possible sortie, à condition d’un changement de l’état des esprits : « d’autres encore qui n’ont pas envie de penser trop longtemps à la misère humaine préfèrent en parler d’une façon très générale et dire que cette crise de l’homme est de tous les temps. Mais ce n’est pas une sagesse qui vaut pour le prisonnier ou le condamné. Et en vérité, nous continuons d’être dans la prison en attendant les mots de l’espoir. Les mots d’espoir sont le courage, la parole claire et l’amitié. Qu’un seul homme puisse envisager aujourd’hui une nouvelle guerre sans le tremblement de l’indignation et la guerre devient possible. Qu’un seul homme puisse justifier les principes qui conduisent à la guerre et à la terreur, et il y aura guerre et terreur (…) Il y a terreur parce que les valeurs humaines ont été remplacées par les valeurs du mépris et de l’efficacité, la volonté de liberté par la volonté de domination. On n’a plus raison parce qu’on a la justice et la générosité avec soi. On a raison parce qu’on réussit. A la limite, c’est la justification du meurtre »[6]. La politique des corps doit être la base de toute politique : « il n’y a qu’un seul problème aujourd’hui qui est celui du meurtre. Toutes nos disputes sont vaines. Une seule chose importe qui est la paix. Les maîtres du monde sont aujourd’hui incapables de l’assurer parce que leurs principes sont faux et meurtriers… Ceux qui ne veulent pas tuer doivent parler et ne dire qu’une seule chose, mais le dire sans répit, comme un témoin, comme mille témoins qui n’auront de cesse que lorsque le meurtre, à la face du monde, sera répudié définitivement »[7].
Guerre et peine capitale, qui sont toutes deux du ressort de l’Etat, anéantissent les corps vivants et vont donc à l’encontre de la politique qui consiste à « sauver les corps ». D’où ces très belles et éloquentes paroles de Camus en faveur de leur abolition universelle. Mais cette volonté de « sauver les corps » ne doit pas s’arrêter là. Il faut, dans un second temps, faire obstacle à toute violence indirecte sur les corps. Et l’humiliation, et la honte qui en résulte, font partie de cette violence indirecte exercée sur les corps. La parole, en effet, s’inscrit sur le corps qui, comme nous l’avons vu, est corps parlant et corps parlé. L’humiliation, qu’elle soit collective ou individuelle, brise le processus symbolique qui érige le corps en corps idéal. Comme dans certains cas psychotiques, un simple regard apparemment déplacé ou méprisant peut alors abîmer l’image du corps ; la moindre perturbation, aussi infime soit-elle, suffit pour déclencher un comportement de violence chez le sujet qui se sent humilié. La violence symbolique quotidienne – même un simple regard – peut produire, si ce n’est un acte violent, du moins une certaine violence verbale. « Que me veut l’autre ? Pourquoi me regarde-t-il ainsi ? ». Parfois, le sentiment de honte peut devenir insoutenable et le sujet ne perçoit plus alors son image dans son intégrité, mais perçoit un corps éclaté, abîmé sous les décombres de l’idéal du moi. Publiquement humilié, le sujet perd pied dans le réel, un sentiment d’angoisse suscité par la honte le submerge et déstabilise complètement sa position dans le champ symbolique. Confronté aux exigences du surmoi, il ne peut plus reculer : son corps lui échappe, aveuglé par l’angoisse et la souffrance. Au fond, l’humiliation, le meurtre, la guerre sont trois manifestations différentes d’un même acte fondamental : l’acte violent, celui qui, comme l’écrivait Camus, substitue aux valeurs humaines « les valeurs du mépris et de l’efficacité », à « la volonté de liberté (…) la volonté de domination ». La volonté d’humilier fait partie de ces principes faux et meurtriers, car « il n’est rien que les hommes se fassent payer plus cher que l’humiliation », ainsi que l’observait Nietzsche[8]. La blessure de l’idéal de soi, l’atteinte profonde de l’honneur, que provoquent l’humiliation et la honte enclenchent le cycle de la violence meurtrière. Alain, quoique très différent de Nietzsche sur le plan philosophique, le rejoint sur ce constat : « l’honneur ne regarde pas seulement à l’opinion ; il y a une morsure intime de l’homme qui se sent lâche, ou qui seulement craint de l’être. Toutes les guerres viennent de là, ce sont des affaires d’honneur »[9]. Il semble bien en effet qu’on ne puisse lire et penser l’histoire des deux derniers siècles (et sans doute au-delà) sans accorder une attention toute particulière aux sentiments d’injustice, de mépris, d’humiliation et de ressentiment de toutes natures.
Le cas de la Grèce : une histoire jalonnée d’humiliations collectives
Le cas de la Grèce depuis un siècle apparaît, de ce point de vue, assez significatif. La Seconde Guerre mondiale laisse derrière elle un pays complètement ravagé et ruiné. La misère insupportable, à laquelle viennent s’ajouter les oppositions idéologiques, favorisent l’instabilité politique. Le retour à la normale a du mal à s’imposer : les escarmouches se multiplient dans les grandes villes et s’étendent bientôt au reste du pays. Affaiblie par le conflit mondial, livrée à l’impuissance, paralysée par les dissensions politiques, la Grèce sombre alors dans la guerre civile dans les années 1946-1949, au moment où les autres pays européens entament leur processus de reconstruction. Cette situation d’exception débouche sur la défaite de la gauche et précipite la division du pays entre vainqueurs et vaincus. Toute humiliation politique comporte une part d’agression, « dans laquelle l’un (collectif ou individuel) blesse, outrage une victime sans que soit possible une réciprocité »[10]. La conduite d’une politique anticommuniste n’est bien sûr pas spécifique à l’histoire grecque. Il en va en revanche autrement du désastre militaire essuyé en 1922 à l’occasion de la guerre gréco-turque. La déroute d’Asie Mineure est en effet très durement ressentie par la population grecque, qui y voit une immense humiliation nationale. Si l’on veut comprendre pourquoi la défaite de la gauche à l’issue de la guerre civile est vécue de façon si humiliante sur le plan collectif, il faut remonter à la catastrophe militaire de 1922 : ce traumatisme national marque durablement l’histoire du pays, au moins jusqu’à la chute de la dictature des colonels à la fin de l’année 1974. La durée exceptionnelle de cette humiliation n’a pas été sans conséquence sur la mémoire collective des Grecs. Au lendemain du deuxième conflit mondial, le pays a comme stagné dans un éternel présent, un présent silencieux marqué par la sidération de la parole. Les Grecs connaissent des années de pierre, au moment où les autres Etats européens entrent dans les Trente Glorieuses. Privés de parole, ils ne peuvent mener à bien le travail de mémoire nécessaire pour sortir de l’impasse et construire leur futur. Il faut admettre qu’à l’inverse des sentiments des vainqueurs, bruyamment exprimés, les sentiments d’humiliation, obscurs et généralement tus, échappent facilement à l’observateur. Les vainqueurs ont tout fait pour réduire les vaincus au silence, de la loi sur le déplacement administratif à la loi sur l’espionnage. Les prisonniers, qui ne tardent pas à se multiplier, vivent dans l’exclusion au sein de leur propre pays. Malgré les timides, et d’ailleurs éphémères, tentatives de libéralisation du régime, c’est incontestablement la logique répressive qui domine durant toutes ces années : les actes de torture, les emprisonnements discrétionnaires, les exils forcés, les enlèvements se succèdent à un rythme effréné. Les vainqueurs mettent en place leur idéologie anticommuniste dans un état d’urgence marqué par la peur, largement fantasmée, d’une rébellion communiste. Ils parviennent ainsi à établir un état d’exception durable pour les vaincus, un présent perpétuel placé sous le signe de l’humiliation réitérée et de l’interminable sidération de la parole. Cet état d’exception, que Freud décrit à l’échelle individuelle et qui surgit en situation analytique, est tel que le sujet « se fonde sur la conviction qu’une providence particulière veille sur lui qui le préservera de tels sacrifices douloureux »[11].
Réactivation du trauma et recouvrement de l’honneur
Pour qui se soucie de mesurer le poids des facteurs historiques dans la structuration de la subjectivité grecque, il importe de ne pas taire les clivages et les divergences idéologiques autour de la conception de la justice politique. Si l’on admet que le lien social se définit aussi par l’inconscient, il faut se pencher sur le sentiment d’exclusion que celui-ci recèle, un sentiment qui relève à la fois de l’intime et du social. L’exclusion s’accompagne d’une forme de mutisme. Mutisme qui était celui des vaincus de la guerre civile, mutisme qui est aussi celui des citoyens frappés aujourd’hui de plein fouet par la crise économique. Cette crise économique, et plus particulièrement la crise de la dette qui a éclaté en Grèce, a fait surgir, après la surprise et la panique aisément compréhensibles, un sentiment d’humiliation. Le trauma des humiliations de 1922 et de la guerre civile se trouve réactivé. Nombre d’individus se sentent aujourd’hui disqualifiés comme sujets sociaux. Alors que la socialisation remplit un rôle majeur dans la subjectivation de l’homme, l’exclusion le place en revanche dans une situation de manque dramatique, dont témoigne la perte de parole. Que reste-t-il lorsque la parole disparaît ? Un préjudice historique né d’évènements vécus par la majorité d’une population sous le mode du traumatisme génère la honte et l’humiliation à l’échelle collective. Le malaise s’installe. Exclusion et pauvreté s’engendrent l’une l’autre ; la sidération de la parole provoque avec pertes et fracas un violent sentiment de honte. En ce sens, par la violence symbolique exercée sur le corps du sujet honteux, par la blessure de l’idéal du moi qui s’inscrit au plus profondément de lui, la crise de la dette se double d’une « crise de l’homme » au sens où l’entendait Camus. Prisonnier de sa honte et d’un pareil piège affectif, l’individu ne peut plus se percevoir en qualité de sujet mais en tant qu’objet de préjudice.
Existe-t-il un lien entre l’histoire d’un pays et la structuration, à l’échelle collective, d’un caractère national ? Comment cela se manifeste-t-il sur le plan clinique ? Quand Freud évoque le « passé lourd de souffrances »[12] d’une nation, il en rend compte par le mode d’agir et d’être[13]. Ce sont précisément ces modalités d’action et d’existence qu’il convient de repérer dans la manière dont les vaincus s’organisent et se perçoivent jusqu’à leur retour dans la vie sociale et politique en 1974, comme il conviendra dans les années à venir de voir comment les Grecs se relèvent de la crise économique. Le discours qu’ils élaborent alors sur leur propre passé prend, après d’interminables années de silence, des allures de revanche. Le passé réel et obsédant, lourd de souffrances accumulées, empêche le sujet de se réconcilier avec la réalité et lui impose, pour survivre, d’idéaliser son trauma. Le trauma devient alors foyer d’énergie, source de l’idéal agonistique. Le corps psychologique, comme le corps biologique, développe des stratégies de survie. Le corps cherche lui-même à se sauver. C’est ce que fait noter René Major : tandis qu’en Grèce se met en place « une économie de la dette qui se fonde sur une réduction d’une partie de la population à une forme d’esclavage pour surendettement de l’Etat », il est nécessaire de rappeler « que le véritable début de la démocratie athénienne remonte pour Aristote à Solon, législateur et poète athénien qui condamna l’esclavage pour dette, parce qu’il constitue une atteinte fondamentale à la démocratie »[14]. Toute humiliation appelle une réaction : c’est ce qui sauve le sujet. Quand le sujet dit non à son humiliation, il dit oui à soi-même. La honte oblige à retrouver l’honneur et la dignité.
La réaction à l’humiliation : excursus sur l’honneur
En effet, l’honneur et la dignité sont pour chacun des valeurs structurales. L’honneur n’est pas qu’une convention sociale. S’il peut prendre une forme ou une fonction différente selon les contextes et les cultures des sociétés, l’honneur est un concept qui reste ancré dans chacune d’elles. C’est ce qu’avait mis en lumière le travail de collecte mené par Jeanne Hersch, directrice de la section de philosophie de l’UNESCO, à l’occasion du 20ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cette collecte de textes montrait combien, à l’échelle de la planète, l’idée d’une dignité spécifique à l’être humain, dont l’honneur doit être respecté, était communément présente dans le monde. L’honneur est avant tout une parole. A cet égard, l’expression « je te donne ma parole d’honneur » n’est pas fortuite. L’honneur fait partie de ces « biens symboliques » qu’évoquait Pierre Bourdieu, dans la mesure où le don (ici, de la parole) vaut acte. Selon Christian Geffray, la parole d’honneur est la parole qui se porte garante, qui éloigne le doute ; elle est celle du contrat non écrit. Elle traduit le besoin humain de faire confiance à autrui. Sa forme varie dans le temps, et dépend de l’histoire des hommes « mais son principe échappe à l’Histoire et relève du langage et des lois de la parole »[15].
Eternelle, la fonction symbolique humanise depuis toujours le rapport de l’homme au langage en imposant sa loi. La découverte de l’inconscient révèle chez l’homme cette présence du symbolique et prouve scientifiquement qu’il n’est pas qu’un être biologique. En s’inspirant des travaux de Lévi-Strauss, Lacan identifie dans le nom du père le signifiant nécessaire à l’exercice de la fonction symbolique. De cette dernière se déduit le surmoi qui assure le passage de la nature à la culture ainsi que la viabilité du lien social. La fonction symbolique recouvre un vaste ensemble de lois du signifiant qui varie selon l’histoire ou le milieu social des individus. Le surmoi en est l’incarnation. Il plonge ses racines dans toutes les formations symboliques qui ont préexisté aux sujets mais il s’impose à chacun d’eux séparément en qualité de gardien du signifiant. En d’autres termes, Lacan mobilise la fonction symbolique à un stade très précoce de la structuration subjective et donne au surmoi un statut symbolique trouvant ses racines dans les échanges symboliques ayant même précédé la naissance du sujet. L’appartenance à la communauté humaine a un coût. Si le surmoi est responsable de l’hominisation, il reporte aussi sur le nouveau-né les dettes symboliques non réglées par les générations antérieures. « Le surmoi comme fonction symbolique vient maintenant de l’Autre de la culture ; c’est une formation de langage qui détermine la situation de l’enfant au regard du système symbolique avant sa naissance ». Dans une clinique de l’idéal, deux éléments capitaux doivent être pris en compte : le nom du père, qui joue le rôle d’opérateur, et le processus d’intériorisation de la loi. L’individu intègre en effet à sa subjectivité tout ce qui a préexisté à sa naissance, telles que les connotations et les coordonnées symboliques spécifiques au groupe social auquel il appartient désormais. Par ce biais, l’extériorité est en quelque sorte intériorisée. C’est alors au surmoi de faire entendre la voix des ancêtres qui imposent au sujet d’endosser leurs secrets, leurs passions mais surtout leurs dettes. Le pouvoir de la parole s’exerce en fonction de connotations culturelles variables. C’est pourquoi le nom du père est un signifiant zéro, vide, qui peut à loisir se charger de sens différents. En définitive, le rôle « magique » du surmoi consiste à torturer le sujet à partir de ce qui vient de l’autre et qui lui préexiste. Il apparaît en effet que la vendetta peut couver, sans se manifester, pendant vingt ou trente ans avant d’éclater brutalement dans un nouveau cycle de haine. Cette réactivation est le fait du surmoi et des conditions sociales dont hérite le sujet « avant sa naissance même ». Si le surmoi lacanien possède une fonction universelle, son contenu, en revanche, est proprement individuel. Il se distingue à la fois du surmoi freudien déduit de l’œdipe et de la première version du surmoi lacanien qui trouvait son origine dans la capture imaginaire de l’imago maternelle. Il a pour fonction universelle d’assurer le passage de la nature à la culture ou, ce qui revient au même, le nouage de l’homme au langage. Ce nouage s’effectue à partir des dettes et des codes hérités par le sujet. « Le surmoi est un impératif, écrit Lacan. Il est cohérent avec la notion de loi, c’est-à-dire avec l’ensemble du système du langage »[16]. Il soumet l’individu pour l’intégrer à la communauté humaine. En ce sens, le surmoi est bien antérieur à la constitution du moi.
Epilogue
Pour revenir au cas-exemple que nous avons choisi, celui de la Grèce, l’on pourrait dire que le surmoi des Grecs est marqué par cette culture de la réaction aux humiliations successives. Ces traumatismes collectifs, vécus comme des préjudices et des humiliations, ont fait naître au sein de la population grecque un sens de l’honneur hérité de leurs ascendants. Si l’humiliation est une « peine de mort » pour le sujet, ce dernier a toutefois la possibilité de recouvrer son honneur et sa dignité. La réaction d’honneur abolit la peine de mort du sujet infligée par l’humiliation, là où l’humiliation prononçait l’abolition du sujet. Aussi voudrions-nous étendre l’appel d’Albert Camus à « sauver les corps » : il ne s’agit plus seulement de « sauver les corps » biologiques, mais encore les corps parlés (par l’autre) et vécus (par soi), en les préservant de la honte ou en leur restituant leur dignité.
[1] Camus (Albert), Ni victimes ni bourreaux, in Œuvres complètes, tome 2 (1944-1948), Paris, Gallimard/La Pléiade, 2006, p. 615
[2] Camus (Albert), La Crise de l’homme, in Œuvres complètes, tome 2 (1944-1948), Paris, Gallimard/La Pléiade, 2006, p. 740
[3] Camus (Albert), op.cit., p. 612-613
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Camus (Albert), « Nous autres meurtriers », article paru dans Franchise, n°3, novembre-décembre 1946
[7] Ibid.
[8] Nietzsche (Friedrich), Humain trop humain [1878], in Œuvres, tome I, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 614
[9] Alain (Emile Chartier), « L’homme d’Etat et son honneur », in Suite à Mars. Echec de la force, Paris, Gallimard/NRF, p. 106-107
[10] Ansart (Pierre), « Les humiliations politiques », in Yves Déloye et Claudine Haroche (dir.), Le sentiment d’humiliation, Paris, Press Editions, 2006, p. 131
[11] Freud (Sigmund), « Les exceptions », in L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1985, p. 157
[12] Freud (Sigmund), « Les exceptions », in L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1985
[13] Assoun (Pierre-Laurent), op.cit., p. 156
[14] Major (René), Au cœur de l’économie, l’inconscient, Paris, Galilée, 2014, p. 106
[15] Geffray (Christian), Trésors. Anthropologie analytique de la valeur, Paris, Arcanes, 2001, p.10. Christian Geffray était directeur de recherches à l’Institut de recherche pour le développement, et membre du Centre d’études africaines de l’EHESS.
[16] Lacan (Jacques), Les écrits techniques de Freud, livre I du Séminaire, Paris, Seuil, 1975, p. 118-119