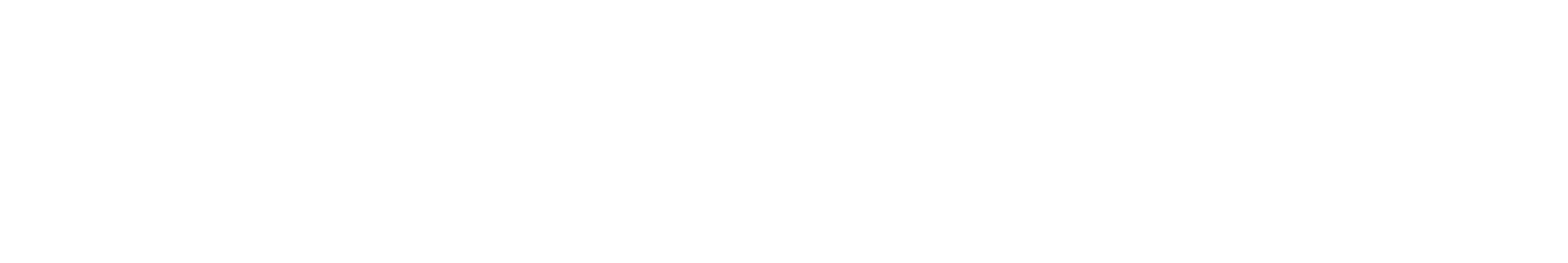Article de Marina Kousouri – Psychologue Clinicienne
L’enjeu freudien : réintroduire la question de l’acte dans la logique psychanalytique par le biais de l’idéal.
Nous avons pu constater bien vite qu’il n’y avait pas de théorie de la réalité du crime chez Freud. En effet, brosser le portrait du criminel serait contradictoire avec la logique psychanalytique qu’il défend de manière quasi-obsessionnelle. En revanche, nous nous sommes concentrés sur la tension que Freud ressentait par rapport à lui-même et par rapport à la norme quand il lui fallait faire face à la nécessité ou à l’obligation de l’acte pour orienter notre lecture épistémologique et repérer les éléments susceptibles de nous offrir un axe de recherche fécond.
Freud suppose en effet que la recherche sur le crime se confond avec la recherche sur la culpabilité. Ce faisant, il nous pousse à aborder la question par le biais de l’idéal et à l’analyser conjointement à son désir. Car il est évident pour lui que la culpabilité ne prend sens que rapportée à la nécessité de sa genèse. Freud ne consacre aucun ouvrage spécifique à la culpabilité bien qu’il fasse de ce concept un emploi massif. En dépit des apparences, la culpabilité n’est pas aisée à cerner notamment lorsqu’elle se manifeste comme une tension torturante qui s’impose au sujet sous la forme d’une dette impérieuse liée à l’idéal. C’est le meurtre du père, déjà conceptualisé en 1913, qui ouvre la voie à l’apparition de l’idéal comme signifiant théorique en 1914 où avec l’introduction du narcissisme s’amorce une révolution métapsychologique qui conduit à une compréhension renouvelée de la genèse du moi.
L’apport majeur de Totem et tabou, qui inaugure une réflexion audacieuse sur les origines, est de situer l’économie du sujet entre deux pôles :
– 1. D’une part, la culpabilité individuelle que Freud détecte dans le symptôme.
– 2. D’autre part, la culpabilité qui se régule en permanence dans le social comme un engagement à ne pas répéter l’acte. Freud tente d’éclairer la logique clinique qui pousse le sujet à se torturer lui-même. Il pose le problème en termes de réconciliation tant à l’échelle collective qu’à l’échelle individuelle. Mais on sent bien que la question l’embarrasse. En réorientant sa théorie de l’interdit vers le travail de l’idéal, il éclaire la structure conflictuelle du sujet, notamment l’impasse mélancolique, et fonde une clinique du social comme si les deux éléments se trouvaient pris dans la même métaphore d’idéal au sein de l’inconscient. Les conséquences de l’hypothèse freudienne de 1914 – qui consistait à faire de l’idéal du moi la condition du refoulement – sont radicales en ce qu’elles postulent que le sujet constitue lui-même son idéal. En d’autres termes, qu’il trouve le moyen de jouer lui-même le rôle de l’autre qui oblige et torture. A cette époque, bien que le surmoi ne soit pas encore conceptualisé, Freud différencie déjà la conscience morale de l’idéal du moi ; il le traite d’ailleurs comme une instance psychique particulière dont le rôle est de mesurer et de comparer le moi à cet idéal. Et l’idéal du moi « dont la garde est remise à la conscience morale » détermine le rapport du sujet au monde extérieur en exerçant au besoin une fonction censoriale.
Pour dessiner à grands traits notre axe de recherche, nous pouvons dire que Freud en cherchant d’une part à éclairer les origines de ce processus et en remaniant d’autre part le concept de libido qui se définit désormais par rapport à son objet, s’interroge sur les causes de l’amour, c’est-à-dire sur la nécessité qui pousse au rapport à l’autre. L’introduction de l’idéal apparaît dès lors comme la garantie nécessaire pour dédommager le sujet de sa perte narcissique. En réalité, si la compréhension du sentiment de l’estime de soi, indissociable de la question de l’amour, peut sembler de prime abord déconcertante, elle devient évidente si nous la considérons à la lumière de Deuil et mélancolie. La mélancolie freudienne, définie comme délire de petitesse, se différencie nettement du deuil. Etroitement liée à l’introduction de l’idéal, elle met Freud sur la piste du surmoi ; elle l’aide en effet à dégager l’intériorisation de l’objet idéal qui se traduit par la culpabilité en raison de la férocité de l’objet. En tâchant de mettre à jour l’influence potentiellement morbide de l’idéal du moi sur le moi, Freud tente d’expliquer la genèse du sentiment de culpabilité, si bien que la mélancolie devient le fil conducteur de son exploration du psychisme, ce qui constitue notre hypothèse.
En élevant le narcissisme à la qualité de « raison d’aimer », il éclaire l’investissement qui, dans la cure analytique, prend la forme du transfert. Au cours de ce transfert, le sujet se livre passionnément à l’objet investi par son idéal. Dans les années qui suivent 1921, Freud prolonge et affine sa théorie. En dépit de quelques flottements conceptuels, il tend ainsi, de manière intuitive, à dissocier le surmoi de l’idéal du moi bien que cette dichotomie ne soit pas encore manifeste. Avec l’élaboration de la seconde topique, l’enjeu clinique de l’idéal rejoint le problème éthique du rapport du sujet à lui-même. Parallèlement à la philosophie, Freud tente d’analyser la mauvaise conscience et le remords en tâchant de découvrir ce qui se joue à l’intérieur du moi. Il s’agit pour lui de repérer l’origine de l’énergie qui pousse à l’idéalisation. Le surmoi se définit comme mandataire du monde intérieur, du ça. C’est cette spécificité clinique qui pousse Freud à introduire la pulsion de mort. Mais cette idée, déjà audacieuse, devient quasiment révolutionnaire quand on la déplace dans le champ du social, comme nous le voyons dans Malaise dans la civilisation.
Autrement dit, quand l’inconscient ne peut pas agir, il parle, et fait découvrir à Freud l’acte meurtrier fondateur. Quand l’inconscient s’active et s’incarne « par » le crime dans ce passage à la réalité extérieure, il confirme la « mauvaise nouvelle » qu’apporte dans ses bagages la psychanalyse, « le moi n’est pas maître dans sa propre maison ».
Freud met l’accent pendant toute son œuvre sur les processus de la mise en acte, ce qui n’est pas la même question que de parler de l’acte lui-même. Avec le meurtre du père, Freud met en place une dialectique où l’inconscient se définit dans son rapport à l’autre, c’est-à-dire que pour qu’il y ait crime il faut forcément un autre mais avant tout il nous faut le « mobile » pour penser la mise en acte inconsciente. Le « mobile » alors, est à chercher du côté de l’idéal, concept subversif dans sa logique où la culpabilité trouve son sens. Plus qu’une faute ou un péché, la culpabilité se donne à réfléchir comme un rapport, où l’idéal se révèle comme la norme au regard de la quelle le moi juge ses pensées et ses actes, tyran féroce envers qui on reste toujours en dette. Une dette qui peut s’imposer comme un impératif ou comme un devoir, de manière à marquer par son absence le manque de l’humanité mais souvent par sa présence, la démesure tragique. De la logique de la censure à la logique du refoulement, Freud avec la conceptualisation de l’idéal contribue de manière décisive à la définition de l’inconscient où il situe cet idéal comme la cause même de l’inconscient. Cette dynamique psychique qui est mise en place se complique par un ensemble des rapports qui créent des « tensions » où le moi mesure au moi idéal d’où il provient l’estime de soi qu’il se porte.
L’honneur, en ce qui concerne notre recherche doctorale, cousu pour ainsi dire à l’envers de la loi, incarne la face morbide de l’idéal qui clive le sujet, le pousse à l’acte et le contraint à choisir. En partant de ce constat théorique, nous pouvons tenter d’identifier la froide nécessité qui avait scellé de la sorte le destin de sujets poussés par l’idéal, voire aller plus loin et essayer de comprendre ce que souvent nous appelons les monstres criminels, les crimes politiques ou fanatiques et poser la question de la responsabilité en d’autres termes et la décharger de la connotation psychotique.
A la réflexion, cette nécessité présente un visage pluriel : à la fois pathogène – elle s’incarne par le crime– elle n’en est pas moins vitale en ce qu’elle soutient et détermine le destin du sujet.
Or pour Freud ce schéma dynamique coïncide trait pour trait avec le mouvement théorique même de la psychanalyse, parce que si dans son œuvre il n’y a pas une théorie du crime ni d’ailleurs une théorie de l’acte, en revanche il met en avant les causes qui provoquent le mouvement du passage « par » l’acte d’une parole évitée. La subversion de l’idéal en métapsychologie renvoie d’emblée à une clinique de l’acte dans le sens où Freud théorise les processus de la mise en acte en les rattachant aux mouvements psychiques. Du coup, notre clinique qui sort de ce qu’on peut appeler une clinique « ordinaire », revalorise la question de l’acte dans la clinique psychanalytique comme un acte « nécessaire » ou encore mieux un acte « obligatoire », en s’éloignant de toute logique psychopathique. Un retour aux sources freudiennes va nous permettre plus qu’une « histoire » de la pensée de révéler que pour le père de la psychanalyse une clinique de l’idéal est avant tout une clinique de l’acte parce qu’elle renvoie d’emblée au « lieu » de l’expérience analytique, au transfert, qui lient pour toujours l’« acte » et la « dette ». La dette ne peut être conçue qu’à partir de la logique de l’idéal, ce n’est pas un hasard si Freud inclut le transfert en métapsychologie à partir de l’idéalisation de l’analyste et en insistant sur la question de la résistance. Freud veut rompre avec la suggestion hypnotique, l’interprétation des rêves ne peut pas lui servir comme pure méthode de l’exploration de l’inconscient du moment qu’il se heurte à l’obstacle de l’« amour » avec les hystériques. La scientificité de la psychanalyse repose sur le transfert et son maniement pour la levée des résistances, « Le combat contre l’obstacle qu’est le sentiment de la culpabilité inconscient n’est pas rendu facile à l’analyste » (S. Freud, 1923, p. 293), nous dit Freud et selon la manière dont le psychanalyste est investi, il peut renforcer cette résistance[1].
En même temps se met alors en place un discours second. Freud en est convaincu : en s’incarnant comme idéal, la psychanalyse le pousse à la nécessité de l’acte analytique et rend possible l’avènement du sens de son désir. Freud contraint par la force de son destin qui s’impose, crée une discipline qui se méfie du « bien », source alors de ses souffrances d’où émane la résistance qu’elle provoque dans le social. C’est une exigence de rigueur peu commune qui semble mouvoir Freud tout au long de son œuvre. A voir le soin qu’il prend à fourbir ses concepts, on devine un souci constant de rectitude et de clarté. Cette disposition intellectuelle vise avant tout à prémunir sa discipline, déjà en butte à de nombreuses malveillances, des malentendus théoriques et des polémiques stériles auxquelles on voudrait lui faire prêter le flanc (S. Freud, 1925). Mais parfaitement conscient que « polémiquer ne mène à rien », Freud décide de passer outre les résistances sociétales et les rancunes personnelles. Fidèle à son destin, il expose le fruit de ses travaux et révolutionne la conception de l’homme en mettant au jour l’inconscient.
En ce sens, une recherche sur l’idéal en psychanalyse ne peut pas ne pas prendre en compte le rapport de Freud avec son idéal, sa propre création, ou encore notre propre rapport avec Freud comme idéal scientifique. Parce que l’angoisse de Freud devant son idéal, exprimé d’une manière quasi obsessionnelle dans ses textes, pose d’emblée la psychanalyse en position d’exception dans le social. « Mais je sais que j’ai un destin à remplir », nous dit Freud. « L’entendement freudien est devenu le destin de l’Entendement dès lors que l’inconscient devient pensable » (P.-L. Assoun, 1984). Nous comprenons alors la position « tragique », au sens des Anciens, dans laquelle se trouve Freud. Il se laisse emporter par son tyran, comme il l’avoue à Fliess dans une lettre datée du 25 mai 1895 : « Un homme comme moi ne peut vivre sans dada, sans une passion ardente, sans tyran, pour parler comme Schiller. Ce tyran, je l’ai trouvé et lui suis asservi corps et âme. Il s’appelle psychologie et j’en ai toujours fait mon but lointain le plus attirant, celui dont je me rapproche depuis que je me suis heurté aux névroses » (S. Freud, 2006, p. 106). « Le tyran fournit donc l’image de la nécessité » (P.-L. Assoun, 1984), une nécessité qui pousse Freud à explorer l’inconscient, et qui, de manière paradoxale, n’est autre que cette loi du désir inconscient : loi cruelle, certes, mais que la psychanalyse respecte et qui fait « parler ». Pour lui, la psychanalyse n’a pas seulement le statut de création mais aussi celui d’idéal scientifique. Au reste, s’il introduit le tragique dans sa théorie, c’est que la blessure de son propre idéal constitue en elle-même un objet tragique. Freud comprend mieux que quiconque qu’il n’a, en réalité, aucun choix à faire. Il est forcé de suivre son destin, à savoir éclairer par la psychanalyse tout phénomène où la dimension inconsciente est impliquée, en prêtant attention aux éléments qui, jusque-là, passent inaperçus.
Du point de vue méthodologique, entreprendre une recherche sur le crime revient donc à entreprendre avant tout une recherche sur la culpabilité qui détermine l’acte. Il s’agit ce faisant de considérer cet acte comme une parole évitée et d’accéder à son déchiffrement. La démarche freudienne est à cet égard éclairante et précieuse. Elle nous éloigne d’une interprétation psychologique du crime, par trop réductrice, et déplace finement le problème sur la « scène » de la métapsychologie, où l’introduction du meurtre du père élève la clinique analytique à la dignité de « drame psychologique » (P.-L. Assoun, 1984).
Heureuse et bien fondée, cette expression nous suggère que la souffrance, toujours intérieure et entachée d’une « faute », surgit de la scène de l’action (dont le sens se retrouve dans le grec drama) où chacun joue et assume le rôle qui lui revient en partage (S. Freud, 1905, p. 126). Qu’elle prenne la forme d’un acte – comme dans le cas de la « pure tragédie » où la « souffrance devient réalité » – ou celle d’un « renoncement » – comme dans le cas d’Hamlet supplicié par l’éternel et lancinant combat que se livrent « l’amour et le devoir » –, elle témoigne d’une réalité profonde de l’existence humaine. De ce destin-fardeau, Freud nous dévoile les deux versants terribles : à l’opposé du héros tragique, révolté et inquiétant, Hamlet, héros du drame moderne, incarne l’homme torturé par son « renoncement » et fascine le spectateur par sa résistance. Qu’on ne s’y trompe pas, le renoncement est sans doute le vrai drame pour Freud, même s’il n’est pas le plus « moral ».
Sur la base de ce constat « tragique », Freud nous oriente vers une lecture signifiante du crime. Il s’interroge sur la nécessité irrépressible qui pousse notre « héros » à l’acte. Il est conduit à s’intéresser au statut de la parole et surtout à la nature du « mobile » dicté par l’inconscient qui motive le passage à l’acte. Pour Freud, ce « mobile » en question a partie liée avec l’idéal, concept décisif et subversif qui révolutionne définitivement le champ épistémologique de l’époque. C’est en effet dans et par l’idéal que la culpabilité freudienne trouve son sens, son origine et sa consistance conceptuelle. Ni la faute, ni le péché ne sauraient épuiser sa réalité qui doit se penser avant tout comme un rapport. L’idéal est en effet l’étalon – ou la norme – à l’aune duquel le moi juge chacune de ses pensées et chacun de ses actes. De ce tyran féroce et implacable, le moi demeure l’éternel débiteur. Cette dette peut alors s’imposer au sujet sous l’aspect d’un impératif ou d’un devoir qui marque tantôt l’inhumanité, tantôt la démesure tragique de l’homme.
Cette réflexion sur la culpabilité chez Freud nous incite à aborder le crime d’honneur par le biais de l’idéal, ce signifiant théorique qui prépare l’arrivée d’un concept clé de la métapsychologie freudienne : le surmoi. C’est dire si, dans cette perspective, la conceptualisation de l’idéal est partie prenante de la définition de l’inconscient. De la logique de la censure à la logique du refoulement, Freud élabore une lecture inédite de l’inconscient désormais mû par l’idéal. Ainsi se trouve mise en place la dynamique psychique à l’origine du refoulement dans la formation de l’idéal. Elle se complexifie de tout un ensemble de rapports par lesquels le moi se mesure au moi idéal : de cette comparaison naît l’estime de soi.
Avec l’introduction de l’idéal, Freud s’impose une tâche titanesque : il se propose de remanier dans le même temps la conceptualisation de la libido et le champ de la psychanalyse. Sa réflexion sur l’amour le conduit en effet à repenser la nécessité du rapport à l’autre comme une spécificité de la psychanalyse. Cette phase témoigne à nos yeux de la ductilité de la pensée freudienne, en perpétuelle reconstruction. A partir d’un souci clinique initial – en l’occurrence, l’étude des origines de la culpabilité –, on peut voir comment elle déborde à tout moment son objet pour s’enrichir de nouvelles problématiques telles que la théorie de l’affect-représentation, la motion pulsionnelle, l’investissement de l’objet ou encore l’introduction de la pulsion de mort.
Pour nous repérer dans ce labyrinthe conceptuel, nous avons choisi de faire du couple surmoi / idéal le fil conducteur de notre recherche. Il apparaît en effet que la genèse du surmoi, en sus d’être liée étroitement à l’idéal, marque le point de basculement de la conscience morale à la culpabilité. Et cette découverte n’est pas mince pour la psychanalyse. A partir de la seconde topique, le surmoi occupera une place telle dans la pensée freudienne qu’il tendra même à être promu à la dignité d’instance psychique particulière. Notons aussi qu’il permettra de conceptualiser la cruauté, ce traitement tyrannique que le surmoi inflige au moi, et le besoin de punition constaté sur le plan clinique dès 1916.
Incontestablement, la réflexion de Freud détermine et nourrit notre axe de recherche. Nous tentons à sa suite de retracer une « archéologie » de l’idéal afin d’éclairer les enjeux et la réalité complexe des crimes d’honneur. Notre hypothèse de départ est que la théorie freudienne de l’idéal renvoie d’emblée à une clinique de l’acte au sens où les processus de mise en acte sont rattachés aux mouvements psychiques.
Conclusion
Si Freud n’a proposé aucune théorie du crime ni même d’ailleurs aucune théorie de l’acte, en revanche, en abordant l’idéal du point de vue métapsychologique, il a su éclairer de façon remarquable et révolutionnaire les origines du passage « par » l’acte d’une parole évitée. Tel est à nos yeux son apport décisif. Il a su distinguer de la clinique « ordinaire » la clinique de l’acte en mettant au jour sa spécificité. Ainsi revalorisé, l’acte criminel a pu révéler son versant nécessaire et irrépressible sans tomber sous le coup de la psychopathie. A l’aune des réflexions anthropologiques de Freud, il nous a paru important d’insister sur le déplacement théorique opéré par Freud qui dans Malaise dans la culture, élève le conflit psychique à l’échelle du social. En mettant en évidence la mélancolisation inhérente à la constitution subjective, nous pouvons dire que le « crime » de Freud est qu’il nous donne une grande mais cruelle leçon de culture, qui, en exigeant une soumission absolue de l’être humain à ses « lois », s’avère en définitive plus féroce que la nature.
———————————————————
-
Il faut dire que l’époque qui voit naître la psychanalyse est marquée par un débat épistémologique qui met aux prises la méthodologie des sciences de la nature et celle des sciences de l’esprit. En effet, le champ scientifique du 19e siècle a vu, ne l’oublions pas, la montée des « humanités ». L’ambition de Freud excède de beaucoup la création d’une simple méthode psychothérapeutique qui viendrait s’inscrire, à la suite des autres, dans les manuels de psychiatrie. Elle dépasse également la simple prétention philosophique.
-
La criminologie est un champ des recherches, depuis maintenant plus d’un siècle, où le crime est un objet d’études. Cette science nouvelle trouve ses origines au Congrès International d’anthropologie criminelle qui a eu lieu à Rome en 1885 et la paternité de cette science est attribuée au médecin C. Lombroso, au magistrat R.Garofalo et au sociologue E.Ferri. Mais, toujours selon les recherches de Professeur Labadie, « rien n’interdit de penser qu’avant même son officialisation existèrent des réflexions sérieuses sur le thème de la criminalité », comme les travaux de F.Voisin en 1838 devant l’Académie de médecine sur la malformation des crânes de la plupart des délinquants examinés.
-
Terme introduit dans Totem et tabou aussitôt avec le meurtre du père
-
Dans une note de bas de page, Freud nous dit que le patient préfère être malade que coupable. Nous pensons que c’est une note de Freud très importante puisqu’ il trouve une similitude de ce processus de renoncement à la guérison avec le processus mélancolique, ce qui renvoie à une mélancolisation d’origine.